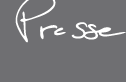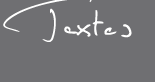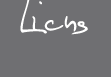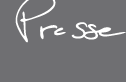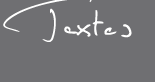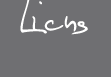|
Christian Comelli : une peinture structurée comme un langage
Un étrange paradoxe : celui qui fait naître d’un certain désordre, des oeuvres qui, une fois achevées, semblent tracées au cordeau. C’est tout l’art de Christian Comelli qui laisse les formes s’imbriquer tout en cherchant à les destructurer. Rencontre.
Cent fois sur le métier remettant son ouvrage, Christian Comelli recommence les gestes ancestraux de ses pairs du passé, auxquels tant d’artistes du présent renoncèrent. Il scie, colle et fabrique un austère châssis. Il y cloue une une toile r^che, il la prépare avec des patiences de bénédiction et puis s’enfonce dans l’obscurité insondable des profondeurs abyssales de la création artisitque, ayant pour seule lampe-totrche son pinceau lumineux. Il est comme son œil unique, cyclopéen et nyctalope, qui ‘il plonge dans le pot de minium comme on enfonce un pieu en terre pour bâtir des palais sidéraux sans plans, sans fondation, au jugé sublimement au hasard.
Mais qui le croirait, tant le tableau, une fois achevé, apparaît structuré, tracé au cordeau des froides cogitations, millimétré, enfanté par le cerveau d’un géomètre non-euclidien ?
Or, Comelli est avant tout un poète et s’il aboutit à une certaine géométrie, il n’es part en tout cas pas : les structures s’engendrent d’elles-mêmes dans ses tableaux que lui fait tout pour destructurer savamment. Et à force de pratiquer systématiquement l’anti-systématisme, il construit des systèmes d’une rigueur et d’une cohérence d’autant plus grandes qu’elles ne sont pas précisément voulues, pas même vaguement ourdies, mais sont le don de ce hasard clément qu’il a su apprivoiser à force de le laisser faire, le « don du tableau » comme Mallarmé parlait d’un « don du poème ».
Il n’y a jamais d’abstraction pure
L’abstraction n’est toujours, au fond, qu’une figuration plus attentive, plus exigeante, plus près ou plus loin des choses. Olivier Debré aimait à dire que l’on peut diviser les peintres abstraits en deux catégories : les « portraitistes » et les « paysagistes ». Et il saute soudainement aux yeux que cette classification est pertinente et qu’il est résolument « paysagiste ». Quand on entre dans les tableaux de Comelli – car on y entre – on ne peut qu’y entrer et s’y promener, les visiter, s’y perdre… Mais toujours on s’y retrouve, car il est des chemins labyrinthiques qui s’enfoncent dans cet étrange pays bleu et gris et brun, où timide est le jaune, discret l’orange, mat le rouge, opaque le noir où la brillance est intérieure. D’abord il faut gratter, il faut creuser, ouvrir une gangue, puis une deuxième et la lumière qui sourd des interstices explose alors en gerbes d’étincelles et c’est une aube éthérée qui se lève sur les décombres du XXe siècle, qui assainit les pestilences émanées du charnier.
Salubre s’avère le vent glacé que souffle la peinture de Comelli : enfin le paysage se dégage, enfin il y a du nouveau ; à l’est à l’ouest les lointains apparaissent et il est incontestable alors que l’art n’est pas mort et que la peinture a encore de longs, beaux et passionnants jours devant elle.
Et il est évident qu’on se trouve au cœur de l’aventure du langage, dont le propre est d’être infinie, de reprendre inlassablement les mêmes mots, éculés, et de les dépoussiérer ; les mêmes tournures grammaticales et non d’y enclore la parole, mais de la libérer en produisant, non moins inlassablement, de l’inédit, de l’inouï, du jamais vu, jamais même pressenti et présenté ici et maintenant, pour toujours, à jamais.
|